Surveillance des AES en secteur hospitalier
L’étude des circonstances de survenue des accidents avec exposition au sang (AES) a permis au GERES, dès les années 90, d’identifier les facteurs de risque d’accident et d’orienter la prévention. Les premières études menées chez les infirmières de Médecine et de Réanimation ont notamment permis de repérer les gestes infirmiers invasifs les plus à risque et de souligner l’importance d’une surveillance des AES .
Une harmonisation des méthodes de recueil et d’analyse des données a été réalisée en 2002 au niveau national par le RAISIN (Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales) en collaboration avec Santé Publique France et le GERES, permettant grâce à un réseau de médecins du travail d’établissements de santé de mettre en place à partir de 2003 une surveillance nationale.
En 2014, plus de 1000 établissements publics et privés participaient. Cette surveillance a permis d’améliorer la connaissance des AES et de guider les stratégies de prévention (mesures organisationnelles, techniques, formations). Elle s’est arrêtée depuis le 1er janvier 2016
Le dernier bilan national de cette surveillance est présenté :
- sur le site de Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/surveillance-des-accidents-avec-exposition-au-sang-dans-les-etablissements-de-sante-francais.-reseau-aes-raisin-france.-resultats-2015
- dans le diaporama : Surveillance des accidents exposant au sang (AES) en France . Mise à jour décembre 2023
Ce bilan montrait, de 2008 à 2015, sur une cohorte stable de 231 établissements de santé (ES) une diminution constante des AES et suggérait que la sécurité d’exercice des professionnels de santé avait nettement progressé.
Cependant, suite aux nombreux appels d’établissements souhaitant poursuivre en interne la surveillance de leurs AES malgré l’arrêt du réseau Raisin-AES, le CPias Bourgogne Franche-Comté a développé la version 2 de l’outil WebAES (financement Santé publique France).
WebAES#2 est mis à disposition des ES à titre gracieux pour la surveillance de leurs AES :
- L’inscription se fait via l’annuaire national des CPias : une fois inscrit, un mail automatique est adressé pour donner les login/mot de passe permettant de se connecter à l’application
- Accéder à l’outil WebAES#2 : https://aes.chu-besancon.fr/
- En cas de problème d’inscription ou pour toute information complémentaire, contactez votre CPias (pour des raisons techniques, un délai peut être nécessaire avant que votre inscription soit effective)
- Protocole 2015 (toujours valable ) : fichier pdf (51 pages)
Cet outil permet également de participer, à partir des données ainsi recueillies, à des enquêtes ponctuelles sur les AES les plus à risque que sont les accidents percutanés (APC) : une telle étude a pu être menée en 2019 en collaboration avec le GERES (consulter le bilan APC IDE 2019)
Les 3 principaux enseignements de cette étude sont les suivants :
- Un taux d’APC de 3,6 pour 100 ETP d’IDE (IADE et IBODE inclus), voisin de celui évalué en 2015.
- Les APC en 2019 :
- surviennent encore majoritairement après le geste, avec un taux d’évitabilité de 29%.
- une part importante lors de gestes chirurgicaux (taux d’APC chez les IBODE = 13/100 ETP ; 22% des APC en bloc opératoire).
- 73,8% des accidentés ont été pris en charge dans les 4 heures après l accident
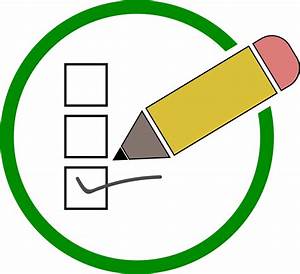 Il est proposé de renouveler cette enquête cette année afin d’avoir une nouvelle évaluation de l’évolution de ces accidents. En effet, suite à la période de la COVID-19 qui a été très lourde pour les soignants et les difficultés en termes d’effectifs rapportées dans de nombreux ES, une ré-augmentation des AES est possible.
Il est proposé de renouveler cette enquête cette année afin d’avoir une nouvelle évaluation de l’évolution de ces accidents. En effet, suite à la période de la COVID-19 qui a été très lourde pour les soignants et les difficultés en termes d’effectifs rapportées dans de nombreux ES, une ré-augmentation des AES est possible.
Pour participer ou vous informer sur les conditions de participation :
Surveillance des AES en secteur libéral
A la demande de l’Ordre National des Infirmiers (ONI), le CPias Bourgogne-Franche-Comté a développé la plateforme WebAES-Ville permettant aux infirmiers libéraux de déclarer leurs AES.
– Accédez à la présentation de la surveillance sur le site de l’ONI
– Accédez à la plateforme WebAES-Ville de déclaration des AES sur le site du Cpias Bourgogne Franche Comté
Mise à jour : février 2024
